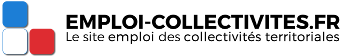Emploi – Collectivités - Mai 2024
Entretien avec Philippe MOCELLIN
Directeur Général des Services de la Ville de Perpignan
DGS « Construire le futur de nos territoires ! » - Part 1/2
Emploi-Collectivités : Vous avez souvent évoqué lors de précédentes tribunes l’importance des démarches de prospective qu’il conviendrait d’engager dans nos territoires… ?
Ph. MOCELLIN : Dans le climat d’incertitude dans lequel nous vivons, nous n’avons jamais eu autant besoin de prospective et de sens à donner à l’action publique locale.
En ce qui me concerne, c’est une conviction profonde que j’avais tenté de faire partager, au travers d’un ouvrage, paru en 2009, aux éditions L’Harmattan et co-écrit avec Liam Fauchard, pionnier du Groupe FuturOuest : « Conduire une démarche de prospective territoriale ».
Dans cette modeste contribution, qui n’est pas un livre de « recettes », il s’agissait de promouvoir l’esprit d’anticipation, appliquée à la réalité et à la diversité de nos territoires.
Le propos est d’ailleurs illustré par une mise à jour de nombreux exemples d’exercices de prospective exploratoires, menés de la Charente à la commune d’Allaire, en passant par le pays Boulonnais…
Je dois aussi beaucoup à Hugues de Jouvenel, créateur de l’excellente revue de référence « Futuribles » (contraction de « futurs » et de « possibles ») - fils de Bertrand de Jouvenel, grande figure de l’école française de prospective, fondateur de l’association internationale Futuribles - avec qui j’ai pu échanger et travailler en diverses circonstances, dans le cadre de la conduite de démarches de prospective.
Je retiens de ces expériences du passé une quasi-certitude : que la prospective et son éventail de méthodes disponibles, à la différence de la prévision statistique ou même de la prophétie, constituent des outils indispensables pour aider à la décision publique.
Plus encore, c’est surtout considérer que la politique doit retrouver toute sa place, indiquer le cap à suivre et lutter contre son penchant « court -termiste » en s’extrayant, autant que faire se peut, de la tyrannie de l’instantané…, à l’heure des réseaux sociaux et du débat en ligne… !
Pour répondre à votre question, l’action publique doit alors démontrer une réelle capacité à conserver une vision de long terme, au regard de toutes les menaces, économiques, sociétales, financières et environnementales qui pèsent sur l’humanité et notre civilisation.
A l’échelle de nos territoires, confrontés aux crises successives, aux défis de société et à la raréfaction de leurs moyens d’action, l’anticipation est un devoir absolu.
J’ose même affirmer, en écho à un propos déjà développé, que les élus locaux - les Maires en particulier - qui seront en capacité, dans ce contexte calamiteux, de dépasser l’horizon de leur propre mandat, en défendant un vrai projet territorial sur le temps long, auront d’autant plus de crédibilité et d’atouts lors des prochaines échéances électorales.
A cet égard, les collectivités locales sont appelées à « manier » prospective exploratoire et préoccupations de long terme et même si, bien souvent, les « résistances » s’organisent, par paresse intellectuelle ou incompréhension, vis à de démarches jugées tout à la fois éthérées et par trop contraignantes…
Ces jugements hâtifs, qui permettent de se donner bonne conscience, en se réfugiant dans l’agitation permanente, éclairent une certaine méconnaissance de ce que nous pouvons attendre de la prospective, intiment liée, à la notion clé de stratégie…
En effet, toute démarche de prospective, invitant à questionner les « clés de lecture » du futur d’un territoire, est censée nourrir un projet d’ensemble et guider les politiques publiques, en assumant des choix.
Jacques de Courson disait que tout élu local, aussi chevronné qu’impliqué au sein de son territoire, est forcément « curieux de prospective, dans la mesure où les résultats de la démarche peuvent lui être utiles pour forger ou consolider son projet politique ».
Si s’interroger sur l’avenir de sa ville est, somme toute, une activité banale pour un Maire ; ce qui est plus difficile, c’est de prendre, dans le tourbillon du quotidien et des sollicitations légitimes, un peu distance et de « levez le nez du guidon ».
Avec pour principe que le futur ne doit pas s’inviter par résignation mais être construit, éclairé par le courage et la volonté.
Il n’est pas seulement question d’aligner des mots et de s’en gargariser.
Il est impératif de mettre en en œuvre des méthodes rigoureuses, laissant aussi une large place aux acteurs locaux qui « font le territoire », qui y vivent… et redonner à chacun, par là-même, une vraie fierté d’appartenance…
Loin de la prévision purement statistique ou de l’extrapolation du passé, il convient d’anticiper les évolutions à venir, avant qu’elles ne s’imposent et obligent à réagir… parce que contraints par les événements, sans posséder de réelles marges de manœuvre.
Quand c’est urgent, c’est trop tard ! disait Talleyrand.
Le « juste à temps » s’oppose de fait à la dimension du temps long, seule manière pour mettre en perspective les projets de développement d’un territoire, autour d’une pensée partagée de l’avenir.
A contrario, l’usage même du « principe de précaution » n’a pas vocation à déboucher sur l’inaction et empêcher toute audace… : ce qui conduirait à prétexter un risque pour ne rien faire… !
Emploi-Collectivités : Pour prendre de bonnes décisions et anticiper, encore faut-il posséder les bons outils d’alerte ?
Ph. M : Tout élu local doit disposer d’informations stratégiques afin de ne pas se trouver « devant le fait accompli » et donc de pouvoir gérer les incertitudes, en décidant en connaissance de cause.
Sans rentrer dans le détail, il s’avère également nécessaire de doter nos territoires d’outils de « veille » en continu, en dépassant la simple notion d’observatoire.
Je plaide pour la mise en place d’instruments « vivants » afin de déceler, face aux accélérations technologiques et aux mutations en cours, les « signaux faibles », et les tendances, annonciatrices de discontinuités…
L’idée est bien de se munir, comme le conseille les prospectivistes, de « vigies », en proposant l’édition annuelle et réactualisée d’un document de référence, faisant état des tendances émergentes concernant des thématiques choisies : économie locale, emploi, modes de vie, urbanisme, démographie…
En indiquant, pour chacune des variables soumises à l’étude, les infléchissements à envisager et les conséquences possibles sur le moyen terme…
Je renvoie ici nos lecteurs aux productions de Futuribles et aux rapports « Vigie », explorant, à intervalles réguliers, les transformations à venir, grâce à l’analyse « des tendances à l’œuvre et à l’identification des ruptures possibles ».
Bien au-delà du « porter à connaissance », l’enjeu est de faire de la prospective et des démarches qui l’accompagnent, des outils de pilotage et d’évaluation de l’action publique locale…
Anticipation, décision et évaluation font partie d’un travail « en boucle », facteur de réussite et d’adaptation au changement.
Dans la réalité du fonctionnement de nos organisations territoriales, les réticences technocratiques sont d’ailleurs très fortes à l’égard du champ de l’évaluation des politiques locales et pourtant, si indispensable à une gestion raisonnée de l’action publique.
Reconnaissons-le, nos institutions locales, d’abord chargées de réaliser des programmes d’action pour le compte des décideurs, sont généralement peu enclines à accepter de « se remettre en cause », au travers d’exercices de « mise à plat », destinés à faire évoluer les pratiques.
Emploi-Collectivités : Pouvez-vous préciser en effet à quels questionnements renvoie la prospective ?
Ph. M. : Il nous faut revenir sur les fondements de la prospective, telle qu’envisagée, dès l’origine, par Gaston Berger en 1957 et telle qu’entendue, selon Pierre Massé, nommé Commissaire général au plan, par le Président Charles de Gaulle, en 1959, à savoir : une « indiscipline intellectuelle », loin du « catéchisme » de la pensée unique.
En effet, une science critiquable, comme toute science et faisant la promotion d’un état d’esprit, tourné d’abord vers la créativité et l’échange constructif.
Et même, en y rajoutant, l’humilité, condition absolue pour faciliter la recherche de la vérité….
C’est d’ailleurs le même état d’esprit qui a présidé aux démarches de prospective qui se sont développées aux Etats-Unis, dès les années 1960, sous l’impulsion de la RAND Corporation, initiatrice de la méthode des scénarios.
La prospective et ses scénarios d’anticipation ne renvoient pas précisément à une boîte à outils toute faite mais sont bien le fruit de confrontations de points de vue divergents sur la vision de l’avenir.
Pour être encore plus précis, la prospective territoriale intègre deux volets d’analyse, forcément articulés : en premier lieu, l’exploration des « champs des possibles » répondant à la question : « que peut-il advenir demain ? » ; et en second lieu, la construction d’un projet « souhaitable ».
Tout exercice de prospective « participatif », organisé à l’échelle locale et en fonction des contextes divers et des menaces ambiantes, comprend alors six étapes fondamentales, à la base de la construction d’un projet de territoire, valorisant des atouts et surtout, les vraies opportunités, à saisir :
-
se « représenter » d’abord la situation actuelle au travers d’une analyse multidimensionnelle ;
-
définir ensuite, en délimitant la question à étudier et ceci, à un horizon temporel long, de 10 à 30 ans, les possibles facteurs de changements et les « ruptures » potentielles ;
-
identifier précisément les variables exerçant une influence possible et analyser les relations entre ces variables ;
-
construire, peu à peu, des scénarios dits « exploratoires et fortement « contrastés », décrivant, à partir d’une problématique identifiée, « ce qui peut advenir » et mettre en évidence les incertitudes, les risques et les défis… ;
-
« faire des choix » en établissant, sur la base de cette exploration du futur, des scénarios dits « stratégiques », destinés à circonscrire le projet territorial et le champ des politiques publiques locales à impulser ;
-
procéder plus tard à la mesure des effets de l’action publique engagée, en répondant à une autre interrogation, « qu’est-ce qu’il est advenu ? ».
Au-delà de ces quelques prescriptions méthodologiques, l’exploration de ces « champs du possible », a aussi pour but de réhabiliter, comme je l’ai déjà évoqué, la « politique », dans sa fonction la plus noble.
En ce sens, prospective et politique constituent, à première vue, des activités complémentaires, bien que distinctes, dans la pratique, comme le sont, d’ailleurs, la prospective et la stratégie…
En effet, aucun (ou presque) « expert » du futur n’avait imaginé ou anticipé le 11 septembre 2001 à New York, les tsunami, l’éclatement de la bulle financière de 2008 ou la crise sanitaire des années 2020…
Et, d’ailleurs, il n’en fallu donc pas moins pour que les responsables politiques dénoncent alors, avec raison, l’imposture des « prophètes » (et non des prospectivistes) de toute nature…
Et pourtant, le monde « politico-médiatique » semble manifester à l’égard des « récits » de prospective, une certaine fascination…
Comme si nos régimes démocratiques avaient aussi besoin de produire du « rêve » afin de dessiner la grande histoire de l’humanité.
En ce sens, tout décideur politique serait avide, d’abord par nécessité, de prospective : celle qui lui permet de justifier, il est vrai, une stratégie d’action.
En précisant encore, qu’il n’est pas ici question de prévoir, comme le font tous les météorologues mais bien d’aider à la construction d’un futur pour nos territoires : s’ériger alors en acteur d’un avenir, encore non écrit, que nous avons décidé collectivement de choisir…ou d’influencer par des décisions partagées et assumées.
Cliquez ici pour accèder à la 2ème partie de l'entretien (suite)