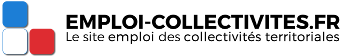De la Troisième République à 1982, droite et gauche s’affrontent régulièrement
A la veille de l’échéance régionale de la fin de l’année 2015, poursuivons notre histoire depuis la Révolution, pour analyser le thème de la décentralisation, avec le deuxième épisode qui nous conduit à la fin du XIX° siècle. Les avancées majeures de la République dans les territoires par la loi du 5 avril 1884 rendent concrètes la décentralisation dans les mairies.
Le programme de Nancy. Il occupe une place capitale dans l’histoire de la décentralisation. Rédigé à la fin de l’Empire, dans sa période plus libérale, il n’est l’œuvre d’aucun poids lourd politique, mais une contribution de plusieurs intellectuels lorrains, dont la phrase capitale résonne comme un écho : « ce qui est national à l’Etat ; ce qui est régional à la région ; ce qui est communal à la commune ». La décentralisation tient son mot d’ordre.
A gauche, la Commune de Paris. Celle-ci prône en 1870 un fédéralisme intégral qui réduirait quasiment à néant le rôle de l’Etat, affolant tout autant les républicains que les conservateurs, et rendant d’autant plus nécessaire une législation décentralisatrice. Au début de la III° République, la gauche, de tradition jacobine, va laisser à la droite – plus exactement aux forces conservatrices – le thème de la décentralisation, avec toujours la nostalgie des particularismes locaux liés aux provinces de l’Ancien régime.
Au centre-gauche, l’apport majeur des républicains « opportunistes » avec la loi du 5 avril 1884. L’avancée majeure de la décentralisation initiée par cette loi a été rendue possible par le retour au pouvoir de Jules Ferry, avec Waldeck-Rousseau au ministère de l’Intérieur. La « République opportuniste » (à l’époque, l’expression n’est aucunement péjorative), fait le pari de la démocratie locale par l’élection au scrutin direct des conseillers municipaux, ainsi que par cette disposition-choc : « le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune ». Par cette loi, la République entre concrètement dans les communes.
A droite, les petits pas. Les vingt premières années de la Cinquième République sont marquées par des avancées timides sur le sujet de la décentralisation, avec notamment l’essor de l’intercommunalité : les syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) voient ainsi le jour en 1959 tandis que les communautés urbaines sont créées en 1966. En revanche, les regroupements autoritaires de communes issus de la loi de 1971 proposée par le ministre de l’intérieur Raymond Marcelin se soldent par un échec. Quant au référendum sur la régionalisation de 1969, son échec n’est bien sûr pas à rechercher dans un refus de décentralisation.
Au centre droit, un régime libéral qui poursuit les avancées. En 1976, le rapport Guichard, père de la DATAR, prône une décentralisation élargie, sans aller toutefois jusqu’à proposer la fin de la tutelle a priori qui pèse encore sur les collectivités : le préfet peut toujours s’opposer aux décisions des maires et demeure l’exécutif du conseil général. Cependant le gouvernement de Raymond Barre fait adopter deux mesures fortes qui, aujourd’hui encore, continuent à produire leurs effets : à partir de 1979, les communes disposent d’une dotation globale de fonctionnement (DGF) pour leurs dépenses courantes et, dès 1980, les collectivités peuvent voter librement leurs taux d’impôts.
Jean-Luc Boeuf
Liens internes :
la décentralisation est-elle de droite ou de gauche ? (1/3)
La décentralisation est-elle de droite ou de gauche ? (3/3)
Lien externe :